Une tentation politique, un risque systémique
Près de 300 milliards de dollars d’actifs russes ont été gelés à travers le monde, dont l’essentiel en Europe. La Belgique, via le dépositaire Euroclear, en détiendrait les trois quarts.
Jusqu’ici, Bruxelles s’était contentée d’utiliser les intérêts générés par ces avoirs pour soutenir Kiev. Mais la Commission européenne pousse désormais à confisquer le capital lui-même, franchissant une ligne rouge juridique et politique.
Une telle mesure reviendrait à violer le principe fondamental de l’immunité souveraine des États, pilier du droit international.
En rompant ce principe, l’Union européenne ouvrirait une boîte de Pandore : demain, n’importe quel État pourrait voir ses réserves saisies pour des raisons politiques.
Ce serait la fin de la confiance qui fonde le système financier mondial.
La fin de la confiance internationale
Confisquer les avoirs d’un État, c’est envoyer un signal d’insécurité juridique à tous les investisseurs étrangers : leurs placements ne sont plus protégés.
Les fonds souverains chinois, arabes, indiens ou africains, qui achètent aujourd’hui la dette européenne, pourraient dès lors s’en détourner.
La dette européenne, déjà fragile, verrait son crédit international dégradé, et les agences de notation sanctionneraient cette imprévisibilité.
C’est une arme à double tranchant : la Russie, déjà coupée des marchés occidentaux, a rapatrié ses capitaux et réinvesti massivement sur son propre sol.
L’immobilier moscovite flambe, les grandes fortunes russes se repositionnent dans l’économie nationale, et les entreprises locales ont remplacé celles parties d’Europe.
Le gel, censé punir Moscou, a déjà profité à la Russie.
La confiscation, elle, profiterait à Pékin, qui verrait s’effondrer un concurrent occidental prisonnier de ses propres contradictions.
Une Europe hors-la-loi ?
Les promoteurs de la confiscation invoquent le principe de réparations de guerre : à l’agresseur de payer.
Mais cette rhétorique de revanche politique bafoue l’ordre juridique international.
Tant qu’un accord de paix ou qu’un jugement international n’a pas établi de responsabilité ni fixé de réparations, aucune base légale ne justifie l’expropriation d’un État souverain.
L’Union européenne se pose ainsi en juge et partie.
Elle substitue au droit la morale, et à la propriété la spoliation — une dérive collectiviste digne des régimes qu’elle prétend condamner.
Car le respect de la propriété et de la parole donnée est la première condition de la confiance dans les affaires internationales.
Et après ?
La guerre finira, comme toutes les guerres.
Il faudra négocier, commercer, reconstruire. Et l’Europe découvrira alors qu’elle a violé la règle du jeu dont elle se disait la gardienne.
Devra-t-elle indemniser la Russie pour ses avoirs confisqués ?
Les contribuables européens devront-ils payer la facture d’un geste symbolique dicté par la morale médiatique ?
Le précédent serait lourd de conséquences.
Si l’Union franchit cette ligne, plus aucun État ne lui confiera ses réserves.
Et l’Europe, se voulant parangon de vertu, aura en réalité signé son propre acte de défiance.
En guise de conclusion
La confiscation des avoirs russes n’est pas seulement une faute politique : c’est une faute civilisationnelle.
Elle trahit une Europe qui oublie que le droit de propriété est la première garantie de la liberté, et que la confiance est le premier capital d’une économie ouverte.
En brisant cette confiance, l’Union ne punit pas Moscou — elle se punit elle-même.

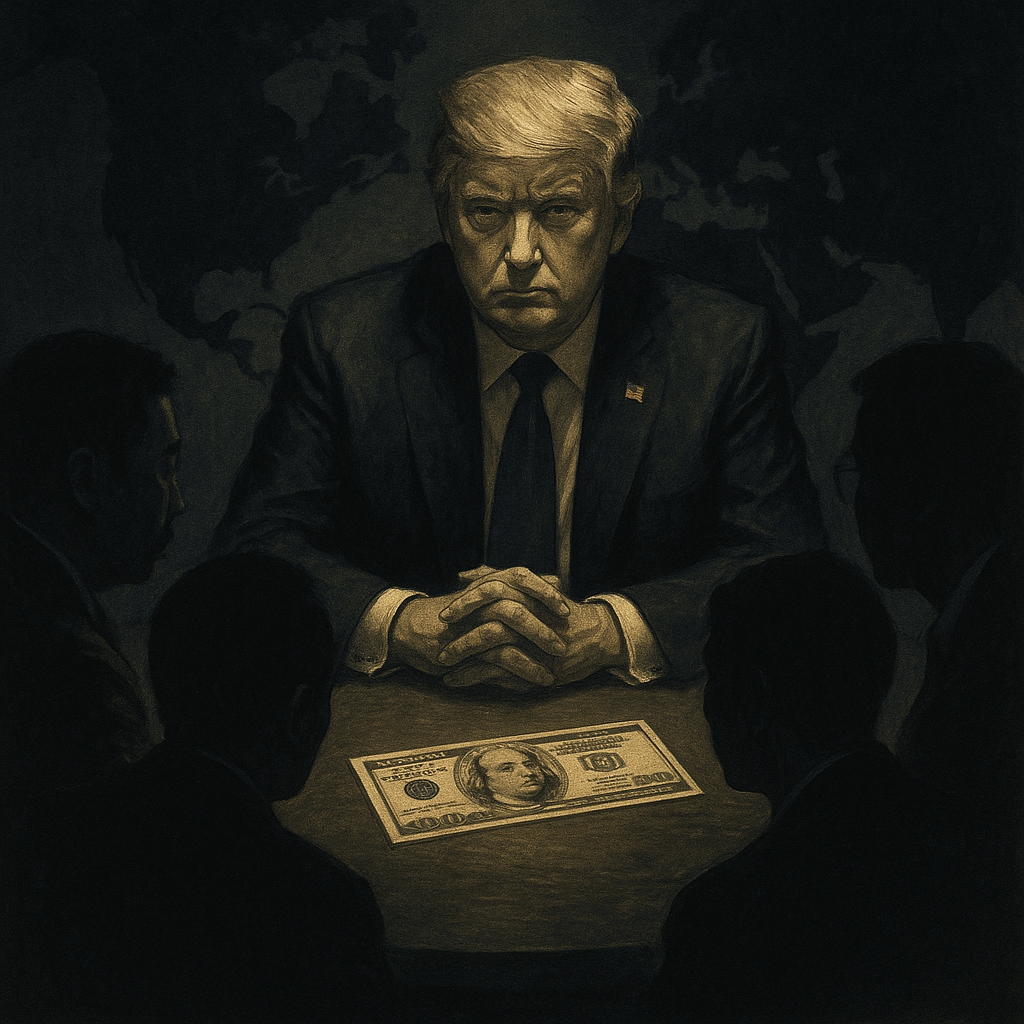
One thought on “Confisquer les avoirs russes : l’Europe au bord du précipice juridique et financier”