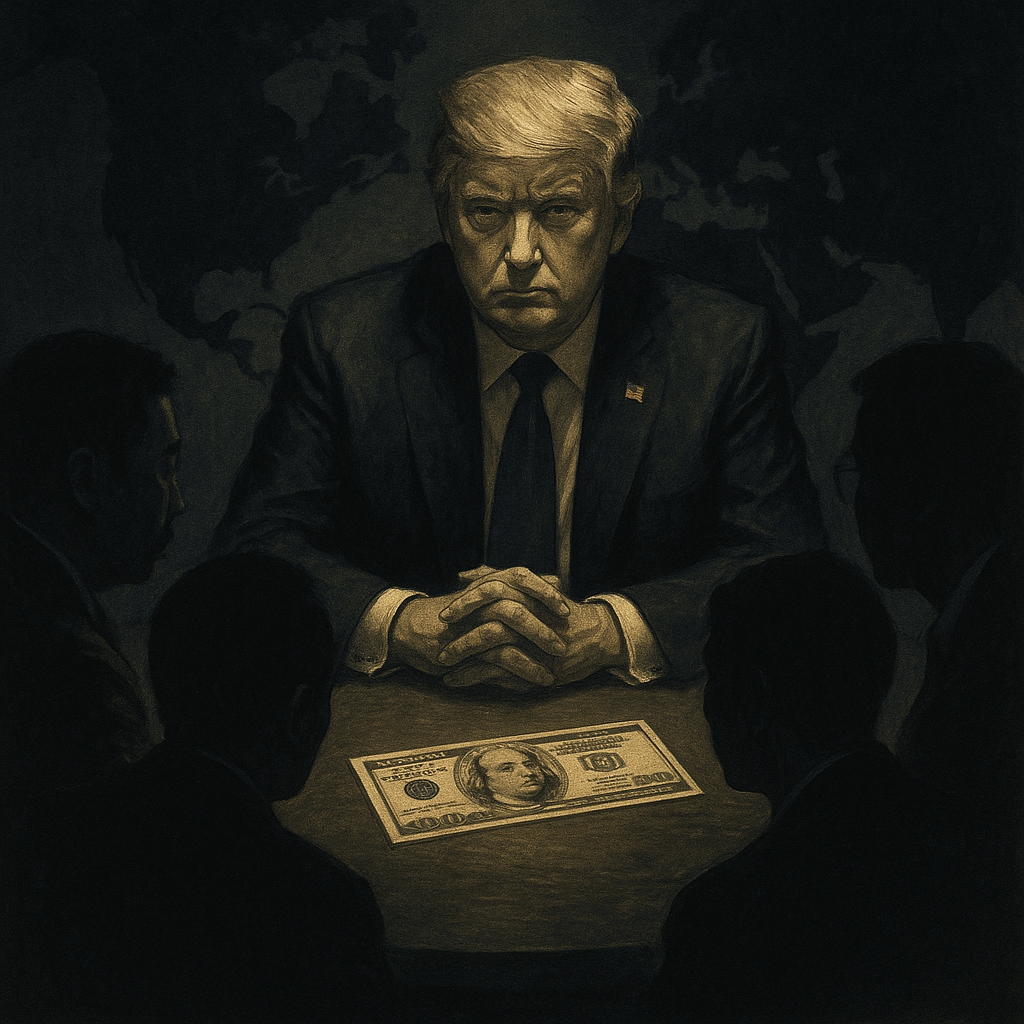Le débat qui agite aujourd’hui la scène économique et politique française se concentre sur la proposition dite « taxe Zucman », inspirée par les travaux de Thomas Piketty et Gabriel Zucman. Derrière l’effet d’annonce, c’est toute une conception de la fiscalité qui se trouve mise à nu et qui mérite un examen attentif.
Des présupposés conceptuels fragiles
L’idée de ponctionner chaque année une fraction du patrimoine, en l’occurrence 2 % du capital d’une entreprise ou d’un particulier fortuné, repose sur des confusions fondamentales. Elle assimile la valeur d’un actif, qui relève d’un stock, à un revenu disponible, qui relève d’un flux. Or, une valorisation sur le papier n’est pas un revenu immédiatement mobilisable.
Il ne faut pas oublier qu’une valorisation boursière ou immobilière ne correspond pas à une liquidité. Une start-up peut être évaluée à plusieurs milliards d’euros sans disposer de trésorerie suffisante pour payer ses salaires. Lui imposer de financer un impôt sur une base purement théorique revient à lui demander l’impossible. De plus, cette taxation repose sur une vision statique de l’économie. Imaginer qu’une ponction annuelle de 2 % du capital puisse se faire de manière régulière et indolore, sans tenir compte des cycles économiques, de la volatilité des marchés ou des crises, relève d’une abstraction éloignée de la réalité.
À cela s’ajoute un autre biais majeur : fonder toute la démonstration en faveur de la taxe Zucman sur l’idée que les Français les plus pauvres paieraient plus d’impôts que les riches revient à nier la réalité de l’impact de la redistribution en France. Dans notre pays, 60 % de la population reçoit davantage de prestations qu’elle ne verse d’impôts, et ces transferts sont financés par les 30 % les plus aisés. On ne peut reprocher à personne de souhaiter que justice fiscale soit rendue, mais encore faut-il que cette justice s’appuie sur une présentation honnête des faits et non sur une affirmation mensongère.
Des méthodes contestables
À ces fragilités conceptuelles s’ajoutent des méthodes qui laissent perplexe. Les tenants de la taxe mélangent allègrement patrimoine, revenus et liquidité, ce qui brouille la compréhension et entraîne des conclusions biaisées. Lorsqu’ils manquent de données, ils comblent les lacunes statistiques par des extrapolations fragiles qui, petit à petit, tiennent lieu de certitudes. Enfin, l’impression qui se dégage est celle d’une narration prédéterminée : les chiffres ne servent plus à éprouver une hypothèse, mais à conforter une thèse idéologique déjà posée. Ce n’est plus de la science économique, mais de la rhétorique militante.
Des conséquences économiques dangereuses
Si une telle taxe devait être appliquée, les effets pratiques seraient délétères. Elle provoquerait une dilution du capital et une perte d’attractivité des entreprises innovantes, déjà confrontées à un environnement fiscal lourd. Elle découragerait l’investissement privé, qui reste la clé de la croissance et du financement de l’innovation. Enfin, elle risquerait d’accélérer la fuite des capitaux et d’affaiblir encore davantage la compétitivité française, ce qui constitue l’exact inverse de l’objectif affiché.
Une logique fiscale dépassée
Au fond, la taxe Zucman n’est que l’avatar le plus récent d’une logique fiscale à bout de souffle. Depuis plus de cinquante ans, la France s’obstine à résoudre ses déséquilibres budgétaires en taxant davantage, plutôt qu’en optimisant ses moyens ou en réduisant ses dépenses. Le pays consacre désormais 54 % de son PIB à la dépense publique, un record mondial. Pourtant, les services régaliens essentiels comme la justice, la police ou l’armée sont sous-financés, tandis que l’État s’est arrogé des missions non régaliennes coûteuses et peu efficaces.
Le paradoxe est cruel : la France est championne de la redistribution, mais lanterne rouge en termes de résultats. Les inégalités ne reculent pas significativement, la croissance stagne et la dette publique explose.
Le poison de l’impôt sur le patrimoine
Face à cette impasse, la tentation de revenir à la taxation du patrimoine ressurgit régulièrement. Après avoir capté une part majoritaire des flux — salaires, bénéfices, revenus —, l’État cherche à ponctionner le stock. Mais cet impôt est destructeur. L’impôt sur la fortune immobilière a asséché les investissements dans le logement et contribué à la crise de la construction. La fiscalité et la réglementation excessives de l’héritage freinent la transmission des entreprises et brident l’innovation. En réalité, taxer le capital productif revient à tuer la poule aux œufs d’or : on assèche la source même du profit futur et donc des recettes fiscales de demain.
À l’heure de la mondialisation, il faut ajouter que les capitaux ne sont pas figés à l’intérieur d’un territoire. Chercher à les surtaxer constitue le meilleur moyen de les faire fuir, offrant ainsi à des pays dont la fiscalité est plus raisonnable l’occasion de s’enrichir pendant que le nôtre s’appauvrit. L’exemple irlandais sur l’impôt sur les sociétés est éloquent : en abaissant fortement sa fiscalité, l’Irlande a attiré des flux massifs d’investissements. Plus récemment, l’Italie a suivi une démarche similaire en réduisant considérablement sa base d’imposition et a vu son activité économique se relancer.
Les leçons de l’histoire
L’histoire devrait pourtant servir de guide. La confiscation des biens de l’Église à la Révolution ou l’épisode catastrophique des assignats montrent que la spoliation appauvrit la nation sans résoudre ses déséquilibres financiers. Croire que la dette publique pourra être réglée par la ponction des patrimoines est une illusion dangereuse. En appauvrissant les entrepreneurs et les épargnants, on réduit inévitablement les recettes fiscales à moyen terme, ce qui alourdit encore la dette au lieu de la résorber.
Conclusion : un faux remède à un vrai problème
Le débat autour de la taxe Zucman ne devrait pas se limiter à une querelle de personnes, entre partisans et adversaires de Piketty et Zucman. La véritable question est de savoir si leurs propositions tiennent la route sur le plan conceptuel, méthodologique et pratique. Tout indique que non.
Et c’est bien là le drame français : nous combattons les inégalités à coups de slogans fiscaux, plutôt qu’avec des politiques cohérentes, efficaces et respectueuses de la réalité économique.