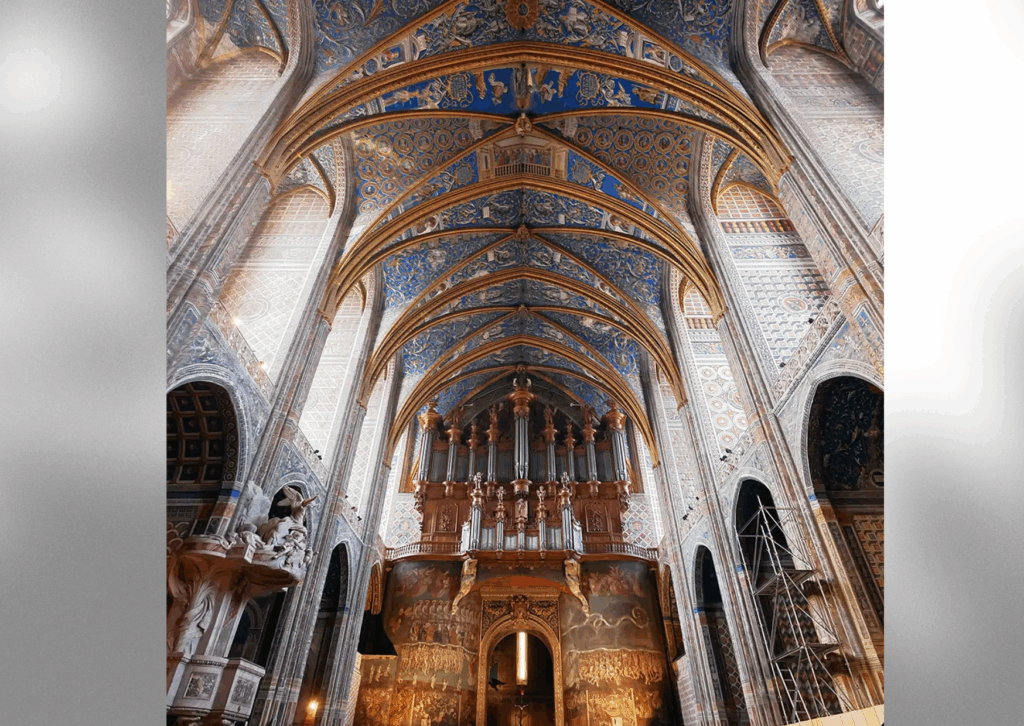On apprend qu’un prêtre du diocèse d’Albi recherche un petit emploi alimentaire pour compléter les revenus de son ministère. L’article s’interroge : le diocèse ne pourrait-il pas mieux rémunérer ses prêtres, lui qui semble entretenir un appareil administratif florissant ? Peut-être. Mais ce n’est pas là, selon moi, le cœur du problème.
Ce que révèle cette situation, c’est la capitulation silencieuse d’une partie du clergé. Car un prêtre vit d’abord de la vitalité de sa paroisse : de la quête, des célébrations, des dons, des activités qu’il suscite. Quand la ferveur s’étiole, c’est rarement parce que le monde est mauvais, mais parce que le sel a perdu sa saveur.
Qu’un prêtre ait besoin de chercher un emploi extérieur dit moins la pauvreté du diocèse que la pauvreté de l’engagement. Où sont les patronages, les colonies, les groupes de jeunes, les cercles d’étude, les soirées paroissiales ? Où est l’élan missionnaire ?
Un prêtre qui évangélise, qui anime, qui rassemble, ne manque jamais de soutien : ni humain, ni matériel.
Quand les associations se lamentent de la perte de leurs subventions, on leur répond souvent : « Réinventez-vous, recréez du lien, mobilisez vos adhérents. » Pourquoi n’en irait-il pas de même pour l’Église ?
Le Christ n’a pas fondé une administration, mais un élan. Si les prêtres deviennent des fonctionnaires du sacré, attendant que l’intendance suive, alors l’Église n’a plus besoin d’ennemis : elle se vide d’elle-même.
Un prêtre, par son ministère, devrait incarner l’espérance et l’énergie du don. Chercher un “job alimentaire”, c’est au contraire admettre que la mission n’a plus de saveur — ni de foi dans sa propre fécondité.