L’accord énergétique et commercial entre les États-Unis et l’Union européenne illustre une fois de plus la difficulté de l’Europe à parler d’une seule voix lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts stratégiques. La France, en particulier, sort perdante d’un dispositif conçu en réaction à des pressions américaines et bénéficiant principalement à l’industrie allemande et, dans une moindre mesure, italienne.
Une Europe alignée sur les intérêts américains
Le prétendu excédent commercial européen de 200 milliards de dollars avec les États-Unis, mis en avant par Donald Trump pour justifier ses tarifs douaniers, est en réalité plus proche de 150 milliards. Dans ce total, la France ne pèse que pour 3 milliards, contre 92 milliards pour l’Allemagne et environ 40 milliards pour l’Italie. C’est pourtant l’ensemble de l’Europe qui paie le prix des mesures américaines, la France comprise.
L’Union européenne, censée protéger ses membres, s’est révélée incapable de défendre les intérêts français. Pire encore, Bruxelles semble s’être inclinée devant les exigences de Washington en acceptant un alignement énergétique catastrophique pour ses équilibres internes.
Un gaz américain trop cher, imposé à l’Europe
Le dossier de l’énergie est emblématique de cette soumission. L’Europe s’est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars d’énergie américaine sur trois ans, soit environ 250 milliards par an. Or, ce gaz naturel liquéfié américain, extrait du gaz de schiste, est non seulement 30 à 50 % plus cher que le gaz russe acheminé par pipeline, mais aussi très mal vu d’un point de vue environnemental. L’Europe, qui prétend incarner un modèle de vertu climatique, s’est ainsi liée à une énergie jugée « non politiquement correcte » par ses propres normes.
La France, qui dispose d’une filière nucléaire souveraine et d’accords solides avec plusieurs fournisseurs d’uranium (Niger, Kazakhstan, Canada…), devra néanmoins contribuer à cet achat massif, sans bénéfice pour elle. Pire, certaines discussions portent sur des achats groupés de combustible nucléaire américain, dans le cadre d’un accord plus vaste sur la sécurité énergétique, alors que la France n’en a ni le besoin ni l’intérêt.
Des investissements européens flous aux États-Unis
Autre sujet d’inquiétude : les 600 milliards de dollars que l’Europe s’est engagée à investir aux États-Unis. Aucune information claire n’est fournie sur l’identité des investisseurs, ni sur les secteurs concernés. À la différence du Japon, qui rend publiques ses intentions d’investissement et les stratégies industrielles associées, l’Europe navigue à vue. Ce « flou absolu » traduit une absence de vision commune et une fragilité stratégique majeure.
Des droits de douane inégalement supportés
L’Europe, tétanisée par les coups de menton de Donald Trump, n’a pas su imposer une riposte commune aux droits de douane de 15 % imposés par les États-Unis. Le Royaume-Uni, désormais hors UE, a négocié de son côté un accord bien plus favorable avec des droits de douane plafonnés à 10 %, preuve qu’une stratégie nationale aurait permis à chaque pays européen d’adapter la réponse à sa situation commerciale. La France, avec un excédent très modeste vis-à-vis des États-Unis, paie donc le prix des performances allemandes, sans avoir pu défendre ses intérêts propres.
Il aurait pourtant été légitime de rétorquer que les consommateurs américains désirent des BMW, des Mercedes et des Ferrari, et que l’Europe pouvait avoir un levier de négociation. Mais l’Europe est restée silencieuse. Le « grand négociateur coriace » Donald Trump a imposé ses termes, face à une Ursula von der Leyen curieusement docile.
Une stratégie européenne défaillante
Cette affaire révèle une pathologie politique plus profonde : l’érosion de la volonté politique européenne, et française en particulier, à défendre ses intérêts vitaux. La France, historiquement dotée d’une diplomatie stratégique et d’une industrie énergétique indépendante, se voit aujourd’hui prise au piège d’accords qui ne servent ni ses entreprises, ni ses citoyens.
En somme, l’Allemagne, avec son excédent structurel, et l’Italie, grande exportatrice de produits de luxe, sont les principales cibles des mesures américaines. Mais la France, pourtant peu concernée par les déséquilibres commerciaux avec les États-Unis, doit partager l’addition. Et cette addition risque d’être très salée.
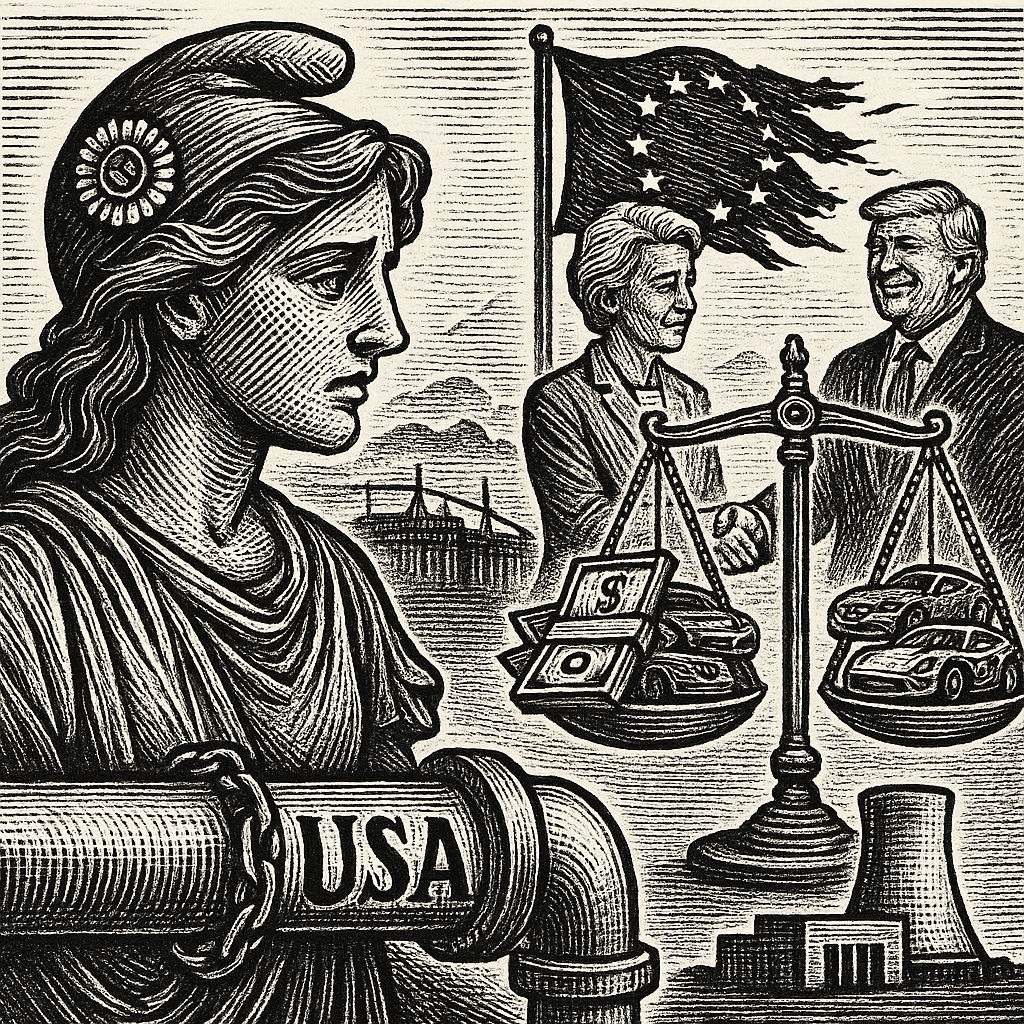

One thought on “La France, victime collatérale d’une Europe impuissante face aux États-Unis”