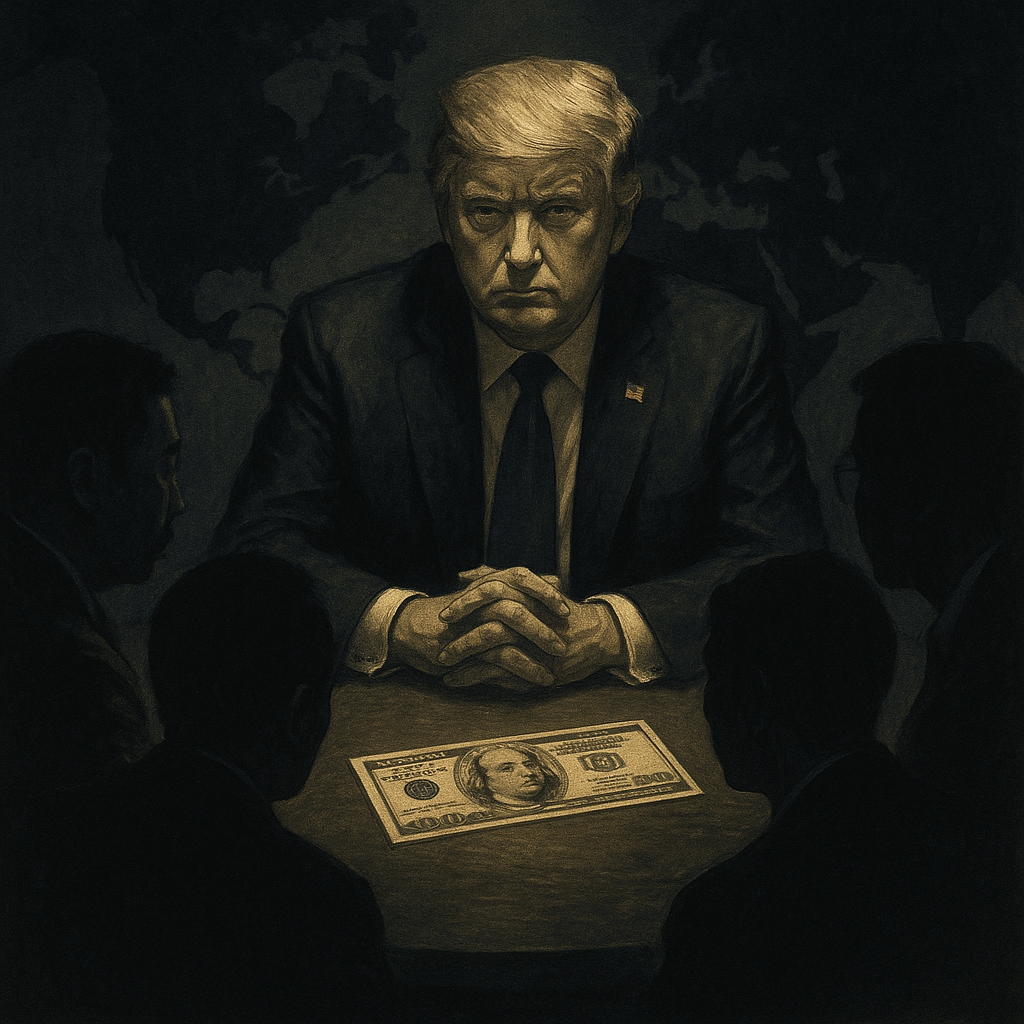Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump semble vouloir appliquer à la dette américaine la même logique qu’à la politique commerciale : celle du rapport de force. Au-delà de la rhétorique, plusieurs indices laissent entrevoir un projet plus vaste, à la frontière de l’économie, du droit et de la diplomatie : la conversion d’une partie de la dette publique américaine en obligations ultra-longues, non négociables, destinées aux détenteurs étrangers de titres du Trésor.
Une idée audacieuse : transformer la dette en quasi-perpétuité
Le concept, attribué à Stephen Miran, économiste proche de l’administration Trump et aujourd’hui membre du Conseil des gouverneurs de la Federal Reserve, consiste à proposer – ou imposer – aux principaux détenteurs étrangers de bons du Trésor (Chine, Japon, pays de l’Union européenne) un échange de titres : remplacer des obligations à 5 ou 10 ans, générant 4 % d’intérêts, par des obligations de 50 à 100 ans, sans coupons annuels et remboursables uniquement à échéance. L’économie pour Washington serait immédiate : une réduction des paiements d’intérêts estimée entre 200 et 300 milliards de dollars par an.
Ce projet, rapporté par Bloomberg, Reuters et analysé par plusieurs think tanks économiques américains, n’a pour l’heure aucun caractère officiel. La Trésorerie américaine n’a pas confirmé la mise en place de tels instruments, et la durée maximale actuelle des titres émis demeure de trente ans. Les « bons à 50 ans » mentionnés dans certaines vidéos ou chroniques n’existent pas dans les adjudications du Trésor – seules des propositions exploratoires avaient été discutées dans les comptes rendus du Treasury Borrowing Advisory Committee.
La logique du rapport de force : le tarif comme levier financier
Si l’idée d’une conversion de dette forcée reste hypothétique, la stratégie de Donald Trump s’inscrit clairement dans une cohérence de contrainte économique. En 2025, la Maison Blanche a instauré un tarif douanier universel de 10 % sur l’ensemble des importations, assorti de hausses ciblées sur certains secteurs stratégiques. Ces droits de douane, selon le propre discours du président, constituent des armes de négociation à l’échelle internationale. Le lien implicite entre tarif et dette est clair : un État acceptant la conversion de ses bons du Trésor pourrait obtenir des allègements tarifaires ou des garanties stratégiques.
Cette vision s’écarte de la diplomatie des années 1980, époque des accords du Plaza où le dollar, alors surévalué d’environ 50 % par rapport au yen et au mark, avait été volontairement déprécié par consensus. La diplomatie du XXIe siècle version Trump est transactionnelle et coercitive : chaque avantage économique devient une monnaie d’échange politique.
Obstacles juridiques et risques de dédollarisation
Sur le plan juridique, une telle conversion serait d’une extrême complexité. Les contrats d’emprunt du Trésor sont protégés par la Constitution américaine (notamment la Public Debt Clause du XIVe amendement). Forcer les détenteurs à accepter de nouveaux termes sans leur consentement relèverait d’une rupture unilatérale des contrats. À moins d’une loi expresse du Congrès, une telle mesure serait exposée à des poursuites et risquerait de briser la confiance mondiale dans le marché des Treasuries.
Les marchés financiers, eux, réagiraient avec méfiance : une dette non négociable perd sa liquidité et donc sa valeur. Les investisseurs exigeraient une prime de risque plus élevée sur l’ensemble des obligations américaines, renchérissant à terme le coût global du financement. Enfin, une telle opération accélérerait les efforts de dédollarisation déjà engagés par la Chine, la Russie et les pays des BRICS, qui cherchent à créer des systèmes de paiement et de financement alternatifs.
Le précédent de 1985 : quand la diplomatie économique était concertée
Les parallèles avec les années Reagan sont instructifs. En 1985, les accords du Plaza ont permis une dépréciation du dollar d’environ 50 % face au yen et au mark, sans déclencher de crise inflationniste majeure. La politique monétaire alors dirigée par Paul Volcker – qui avait porté les taux directeurs à 20 % – avait consolidé la crédibilité du dollar. Reagan menait une politique budgétaire expansionniste (baisse d’impôts, hausse des dépenses militaires), mais l’équilibre global était maintenu par une diplomatie économique multilatérale.
Trump, lui, veut atteindre un objectif similaire – le maintien du leadership du dollar – mais par des moyens unilatéraux. Cette approche comporte un risque majeur : que la première puissance mondiale, en instrumentalisant sa dette, affaiblisse le socle de confiance qui fonde son hégémonie financière.
Et la France dans tout cela ?
La tentation de l’État français pourrait être de s’inspirer de ce modèle pour allonger la maturité de sa propre dette. Mais les marges de manœuvre sont sans commune mesure. La France ne détient pas de monnaie de réserve mondiale, ne peut pas forcer la main à ses créanciers étrangers et n’a pas la même latitude monétaire que les États-Unis. Une conversion à 50 ou 100 ans, sans coupons, serait interprétée comme un aveu de faiblesse et provoquerait une fuite des investisseurs. La dette française, aujourd’hui à 3 300 milliards d’euros, repose sur un marché de confiance où chaque adjudication d’OAT se joue à la marge de crédit perçue vis-à-vis de l’Allemagne.
En revanche, la France pourrait s’inspirer d’une autre dimension du plan américain : la diversification des maturités et la reconstruction d’une base d’épargne nationale longue capable d’absorber une part croissante de la dette. Cela suppose une réforme de l’épargne, non une manœuvre coercitive. Dans un monde où la confiance vaut plus que la contrainte, la force financière ne se mesure pas seulement en dollars, mais en crédibilité.
Infographie : maturité moyenne et structure de la dette publique (2025)
| Pays | Maturité moyenne des titres d’État | Dette/PIB | Monnaie de réserve ? | Principaux détenteurs étrangers |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 6,2 ans | ~122 % | Oui (USD) | Chine, Japon, Royaume-Uni, UE |
| France | 8,3 ans | ~110 % | Non (euro) | BCE, investisseurs institutionnels UE |
| Japon | 9,1 ans | ~260 % | Non (yen) | Marché domestique (95 %) |
Cette infographie illustre la réalité des marges de manœuvre : seuls les États-Unis peuvent utiliser la dette comme instrument de puissance mondiale, tandis que la France ou le Japon doivent composer avec la discipline des marchés et la confiance de leurs créanciers.